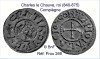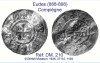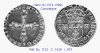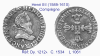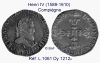|
|
| Monnaies carolingiennes: |
|
||
| Monnaies royales: | |||
|
Charles le
Chauve, roi |
|
Charles le
Chauve, roi |
|
Charles le
Chauve, roi |
|
Charles le
Chauve, roi |
|
|
Charles le
Chauve, roi |
|
Eudes |
|
|
Le trésor de Cuerdale est un trésor viking, constitué d'éléments en argent, qui fut découvert en mai 1840 par des ouvriers en train de réparer une berge de la rivière Ribble. D'un poids de 40 kg. il était constitué de 6765 monnaies (dont 965 pièces françaises), 3 bracelets, 36 anneaux, des chaines et de nombreux fragments de bijoux. Parmi les pièces françaises, ce rarissime denier de Eudes. La totalité de ce trésor est aujourd'hui conservé au British Museum de Londres. |
|
|
Charles le
Simple |
|
* Ce denier est le
seul exemplaire que l’on connaisse de l’émission de deniers de
Charles le Simple pour Compiègne. Il a appartenu à Henri Meyer
puis à Paul Bordeaux qui la publia au Congrès de Numismatique de
Paris en 1900. Pages 245 à 254. Il est possible de consulter l'article ou de le télécharger en cliquant sur le lien suivant: http://fr.scribd.com/doc/74880903/Congres-international-de-numismatique-reuni-a-Paris-en-1900-proces-verbaux-memoires-publ-par-De-Castellane-et-Adrien-Blanchet |
|
Chassé de Paris le 13 mai 1588, à la suite de la journée des
Barricades et de l’insurrection de la Ligue, Henri III se
réfugia à Tours. De cette ville, dans une lettre datée du 23
mars 1589, il ordonna aux officiers de la Monnaie de Paris
de transférer l’atelier monétaire à Compiègne. Mais les
volontés royales ne furent pas exécutées. Aussi, le 26 avril
1589 demanda-t-il à Charles de Humières, gouverneur de
Compiègne de faire « battre monnaie en ladite ville de
Compiègne, à la marque propre particulière de Paris, qui est
un A, première lettre de l’alphabet1 ». La
création de l’atelier monétaire de Compiègne, pourrait, de
cette façon, être considérée, comme étant une délocalisation
de l’atelier parisien ! L’atelier fut d’abord installé dans
l’Hôtel de la Forge, au coin des rues de l’Étoile et des
Lombards. La première délivrance, « monnaies en quarts
d’écu aux coins et armes de Henri troisième, roi de France
et de Navarre » est du 20 mai 15892. L’atelier monétaire de Compiègne cessa son activité en avril 1595. La dernière délivrance est du 3 avril 15952. |
|
1-Bibliothèque Nationale,
manuscrits. Dom Grenier, vol XX, liasse 7. Histoire
civile et ecclésiastique de Compiègne, p. 163 |
|
Henri III |
|
Henri III |
|
|
Henri III |
|
|
L'apparition sur le marché numismatique des deux exemplaires, ici présentés, du rarissime écu d'or d'Henri III frappé à Compiègne, indique que contrairement à ce l'on pensait, la fabrication du 15 juillet 1589 de 435 espèces d'or, ne comprenait pas uniquement des doubles écus, mais également des écus. |
|
|
Henri III |
|
Henri III |
|
Cette pièce comme le double écu d'or au nom d'Henri III est
illégale; la frappe des doubles écus n'a jamais été autorisée
par la Cour des monnaies de Paris pas plus que par la Chambre
des Comptes de Tour qui faisait office de Cour des monnaies pour
le parti royaliste. Ces doubles écus furent décriés en 1590, et Fidelle, maître de la Monnaie, dut les rembourser. (Cf: Jean
Lafaurie: Les monnaies des rois de France). |
|
1 |
|
Schin Hébraïque, marque du maître de la Monnaie Simon de Navarre |
| 2 |
|
c Dans C, marque du graveur Nicolas Béguin |
|
|
Schin hébraïque, marque du maître de la Monnaie Simon de Navarre, figurant en fin de légende du revers de ce douzain. |